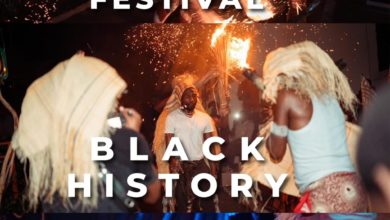Se mouiller la nuque avant de plonger : rituel anodin ou geste vital ?
Chaque été, ce refrain résonne sur les plages : « Mouille-toi la nuque ! ». Un geste hérité de notre enfance, souvent pratiqué sans vraiment en comprendre la raison. Mais derrière cette habitude se cache une question de sécurité cruciale, directement liée au risque d'hydrocution. Alors, simple idée reçue ou réflexe qui peut sauver des vies ? Éclairage.

Le choc thermique, ou l’hydrocution, expliqué
L’hydrocution est un accident redouté, une syncope provoquée par un choc thermique trop violent lorsque le corps, surchauffé, entre brutalement en contact avec une eau froide. Le mécanisme est physiologique : par forte chaleur, les vaisseaux sanguins se dilatent. À l’inverse, le froid provoque leur contraction.
Le passage soudain d’un état à l’autre cause une vasoconstriction brutale – un rétrécissement immédiat des vaisseaux. Le sang circule alors moins bien vers les organes vitaux.
Conséquence ? Le cœur et le cerveau sont moins irrigués, ce qui peut entraîner un malaise vagal et, dans les cas les plus graves, un arrêt cardiovasculaire.
Pourquoi la nuque est-elle si importante ?
Se mouiller la nuque n’est donc pas un geste anodin. Cette zone du corps est particulièrement riche en vaisseaux sanguins et est considérée comme un point de régulation thermique sensible. La mouiller permet d’envoyer un signal fort au corps pour activer progressivement le mécanisme de vasoconstriction. C’est une façon d’habituer l’organisme au changement de température et d’éviter le choc, qui serait bien plus violent si le corps entier était immergé d’un coup.
Les signaux d’alerte à reconnaître absolument
L’hydrocution ne survient pas sans crier gare. Plusieurs signes, physiques et neurologiques, doivent alerter le nageur ou son entourage :
Signes neurologiques : Vertiges, maux de tête (témoins d’une mauvaise irrigation du cerveau), confusion mentale, qui peut précéder une perte de connaissance.
Signes physiques : Pâleur soudaine, chair de poule inexpliquée, crampes musculaires sévères ou sensation de forte fatigue, et troubles du rythme cardiaque.
De l’hydrocution à la noyade : un risque mortel
Il est essentiel de rappeler que l’hydrocution en elle-même n’est pas directement mortelle. Le danger mortel survient si elle cause une perte de connaissance dans l’eau, conduisant à la noyade. Un risque qui n’a rien de négligeable : selon les chiffres de Santé Publique France, les noyades accidentelles sont responsables d’environ 1 000 décès par an et constituent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.
Que faire en cas d’urgence ?
La conduite à tenir face à une hydrocution est identique à celle pour une noyade. Les Sapeurs-pompiers de France indiquent qu’il faut :
- Maintenir immédiatement les voies respiratoires de la victime hors de l’eau pour éviter la pénétration de liquide dans les poumons.
- Sortir la personne de l’eau le plus rapidement et prudemment possible.
- Alerter les secours sans tarder et la sécuriser en attendant leur arrivée.
En conclusion, se mouiller la nuque est bien plus qu’une simple tradition. C’est la première étape d’une entrée progressive dans l’eau, un geste de prévention essentiel pour permettre au corps de s’adapter et ainsi réduire le risque de choc thermique. La prudence recommande également de ne se baigner que dans les zones surveillées, où les équipes de secours peuvent intervenir en quelques secondes en cas de problème.
Source : Informations issues de l’émission Allô Docteurs, compilant les recommandations du Syndicat National des Sauveteurs en Mer (SNSM), de Santé Publique France et des Sapeurs-pompiers de France.