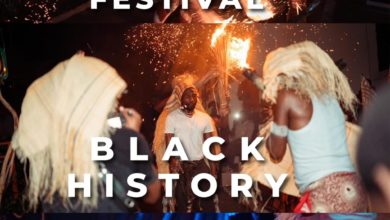EconomieFlashInternational
RCI: Enjeux et limites de la diaspora bond

Et si la solution au financement du développement de l’Afrique se trouvait… hors d’Afrique ? C’est le pari audacieux, et urgent, qui a animé les débats d’un forum organisé à Abidjan par la Fondation Friedrich Naumann. Alors que les financements étrangers se font de plus en plus rares et aléatoires, les « diaspora bonds » émergent comme une arme de souveraineté massive. Mais entre l’idéal et la réalité, le chemin est semé d’embûches.
Une manne financière ignorée ?
Les chiffres, vertigineux, donnent le tournis. 140 millions d’Africains vivent hors du continent, formant une puissance économique dispersée mais colossale. En 2024, ils ont injecté 92,2 milliards de dollars dans leurs pays d’origine – une somme qui dépasse l’aide publique au développement et rivalise avec les investissements directs étrangers.
Pourtant, cet argent sert trop souvent à combler des besoins immédiats. Le défi, désormais, est de le transformer en levier de développement à long terme. « Le véritable enjeu est de transformer cette solidarité financière en investissements productifs », a asséné Alexandra Heldt, de la Fondation Friedrich Naumann, pointant du doigt un gâchis monumental. Pourquoi continuer à quémander des aides capricieuses quand la diaspora représente un pactole stable et engagé ?
Les Obligations Diaspora : bien plus que de la finance
Il ne s’agit pas simplement d’un instrument financier de plus. C’est un acte de foi. « Ils symbolisent un lien fort entre les citoyens et leurs nations, entre le passé et l’avenir », a martelé Mme Heldt. Contre les diktats des bailleurs de fonds internationaux, ces obligations proposent une voie libérale et souveraine : les Africains financent eux-mêmes les projets structurants de l’Afrique, par conviction et non par contrainte.
Dans un monde où « les conflits remplacent trop souvent le dialogue », cette indépendance financière n’a jamais été aussi cruciale. La baisse de l’aide américaine et les crises géopolitiques sonnent comme un électrochoc : l’Afrique doit se prendre en main.
La confiance, seule vraie monnaie d’échange
Mais l’enthousiasme ne doit pas masquer les limites. Le professeur Séraphin Prao, économiste ivoirien, a mis le doigt là où ça fait mal : « Il faut que l’Etat inspire confiance ». Sans gouvernance irréprochable, sans vision à long terme et sans projets innovants, les diasporas, pourtant motivées, ne confieront pas leurs économies à des États opaques.
Le patron d’une agence de notation, M. Stanislas Zézé, a enfoncé le clou en évoquant l’épineux problème de la convertibilité des monnaies. Avec 54 pays dont les monnaies sont souvent inconvertibles, le mécanisme est boiteux. « Briser les barrières d’emprunts inter-États » est impératif. Pourquoi un Ivoirien de la diaspora ne pourrait-il pas investir dans un projet porteur au Kenya ? Le cadre actuel, archaïque, l’en empêche.
Le temps des discours est révolu
L’exemple de la Côte d’Ivoire, qui fait du marché local une priorité, et les succès de l’Éthiopie, du Nigeria ou du Sénégal prouvent que c’est possible. Le volume mondial des diaspora bonds, plus de 50 milliards de dollars, montre que l’outil est viable.
Mais le forum d’Abidjan aura surtout révélé une vérité crue : la balle est dans le camp des gouvernements. Arrêter de parler pour enfin agir. Garantir la transparence, libéraliser les marchés financiers régionaux et proposer des projets bancables. La diaspora, elle, est prête. Reste à savoir si les États le sont tout autant. L’avenir du continent se joue peut-être moins dans les palais présidentiels que dans les portefeuilles d’investisseurs… qui ont un pays au cœur.