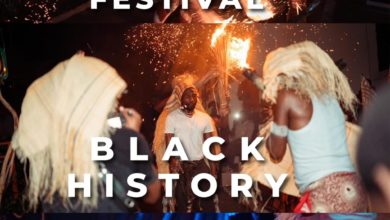Le gouvernement gabonais a choisi la méthode forte pour assainir ses finances. Ce lundi 6 octobre, le ministre d’État Henri-Claude Oyima a annoncé l’effacement pur et simple de toutes les dettes impayées envers le Trésor public datant d’avant 2023. Une décision radicale qui fait office de grand ménage administratif et dessine les contours d’une nouvelle gouvernance économique.
Une volonté affichée de rupture et de transparence

Cette mesure choc, présentée comme le point d’orgue d’une série d’audits, vise à restaurer la crédibilité budgétaire du pays. En effaçant l’ardoise du passé, le pouvoir entend marquer une rupture nette avec des pratiques de gestion souvent décriées. La mesure de Libreville vise à soigner sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds et des investisseurs étrangers en présentant des comptes publics assainis et pose les bases d’une gestion plus rigoureuse pour l’avenir, en partant de zéro.
Une « Task Force » a d’ores et déjà été mise en place, donnant jusqu’au 17 octobre aux opérateurs économiques pour soumettre leurs justificatifs. Le gouvernement défend cette cure d’austérité comme un investissement nécessaire pour la stabilité et la croissance future du Gabon.
L’envers du décor : un risque de fragilisation pour les entreprises
Si la stratégie peut sembler payante sur le long terme, ses conséquences socio-économiques immédiates pourraient être sévères. Cette décision fait peser une lourde menace sur de nombreuses entreprises, et notamment les PME, qui comptaient sur le recouvrement de ces créances pour assurer leur trésorerie et maintenir leur activité et honorer leurs propres engagements (salaires, fournisseurs, investissements).
En annulant ces dettes, l’État résout son problème de passif, mais le reporte potentiellement sur le secteur privé. Le risque est de voir une vague de fragilités financières, voire de faillites, parmi les créanciers de l’État, ce qui pourrait affecter l’emploi et le dynamisme économique à court terme.
Un pari audacieux aux conséquences incertaines
Le gouvernement gabonais joue donc un pari risqué. D’un côté, il envoie un signal fort de rigueur et tente de restaurer la confiance, un prérequis pour attirer les investissements. De l’autre, il secoue violemment l’écosystème économique en privant de nombreuses structures de revenus vitaux.
La réussite de cette politique se jugera à sa capacité à instaurer, dans la foulée, un climat des affaires plus sain et prévisible. Sans mesures d’accompagnement pour les entreprises les plus touchées, ce grand nettoyage des comptes publics, aussi nécessaire soit-il, pourrait se faire au prix d’un assainissement bien plus douloureux de tout le tissu économique gabonais.