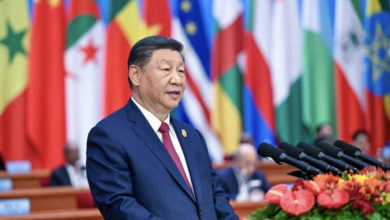À Libreville , comme dans toutes les capitales où le lien familial est sacré et le distributeur automatique souvent à sec, se niche un sport national méconnu : le « sollicite-moi si tu peux ». Entre la pression sociale qui pèse comme une chape de plomb, la reconnaissance éternelle due aux aînés et la nécessité de ne pas finir soi-même à la rue, le travailleur africain moderne est un funambule en costume-cravate, constamment tiré par la manche par une armée de parents à la recherche du Graal : un petit billet.
Sujet qui fâche, sujet qui tue (le budget, en tout cas). Les « sollicitations financières » – ces petites mains tendues qui apparaissent aussi sûrement que les factures en fin de mois – sont le véritable impôt révolutionnaire du continent. Un impôt volontaire, certes, mais dont le non-paiement expose à des peines bien plus lourdes que celles du fisc : la culpabilité éternelle et les regards noirs aux prochains mariages.

Dans les rues de la capitale gabonaise , ce malaise existentiel a trouvé son écho. Aimée, employée du privé, résume le dilemme du travailleur pressé comme un citron : « On le fait par reconnaissance, parce que c’est eux qui nous ont mis au monde. » Elle marque une pause, le regard fuyant, comme si elle allait commettre un sacrilège. « Mais si j’ai déjà trop de charges, je vais… arrêter d’aider les parents. » Un silence gêné. On entendrait une mouche voler, ou plutôt un billet de banque se faire la malle. Car oser mettre un frein à la manne familiale, c’est un peu comme annoncer qu’on arrête de respirer : ça ne se fait pas.
Cette obligation morale, certains l’ont érigée en dogme national. Wilfried Pendy, agent public et apparemment futur béatifié pour sa sainteté financière, assène : « Les parents nous ont aidés depuis notre naissance. Alors si on n’aide pas nos parents, je ne vois pas qui on pourra aider. » Logique implacable : après avoir financé les couches et le lait en poudre il y a 30 ans, lesdits parents estiment que l’investissement mérite bien des intérêts composés. Bervy Kabongo, étudiant et déjà visionnaire, renchérit : « Si je travaille, je ne me vois pas refuser de l’aide à ma mère. » Traduction : « Je me vois déjà vivre dans un studio sans meuble, mais avec le devoir accompli. »
Heureusement, une voix plus… disons, réaliste, émerge du lot. Rodrigue Ekang Mvé, électrotechnicien et fin sociologue du dimanche, apporte sa grille de lecture. Selon lui, il existe deux catégories de parents. « Il y a ceux qui font des enfants pour les faire, et qui veulent leur réussite. » Soit. « Et d’autres qui font les enfants en espérant qu’ils les relèvent, parce que, pardonnez-moi l’expression, ils ont déjà raté leur vie. » On remercie Rodrigue pour sa franchise chirurgicale. Voilà le cœur du problème : la solidarité, oui ; le plan de retraite anticipée sur le dos des enfants, non. Mais essayez donc de faire la différence quand votre oncle vous tend la main avec le regard humide d’un héros de mélodrame.
Alors, comment survivre à ce grand ravin émotionnel sans finir sur la paille, entouré de la considération de tout un quartier mais sans un sou pour payer sa propre sauce ?
Les gourous du développement personnel version pangolin sont formels : la planification. Sortez vos calculettes, nom d’un budget ! Tenir des comptes n’est pas un acte égoïste d’enfant ingrat, mais une déclaration de guerre à la précarité. Il faut oser intégrer « Aide familiale et divers (inévitables) » dans son Excel, au même titre que le loyer et l’électricité. Une rubrique à part entière, un impôt sacré à payer en début de mois, avant même d’acheter le pain.
Car sans cette discipline de fer, le risque est grand de tomber dans les « pièges émotionnels ». Vous savez, ce moment où vous donnez l’argent du transport, puis celui du déjeuner, puis celui de la « petite urgence », et que vous réalisez en rentrant que vous allez devoir marcher jusqu’à la semaine prochaine. Le cycle infernal.
Le débat fait rage dans les sociétés africaines , mais une vérité première commence à percer sous le poids des sollicitations : pour aider tout le monde, encore faudrait-il ne pas finir soi-même sur la liste des bénéficiaires. Et comme dit le proverbe : « Quand le dernier billet est donné, le sage se rend compte qu’il aurait dû garder de quoi acheter une bougie pour éclairer sa propre nuit. » Ou quelque chose comme ça.