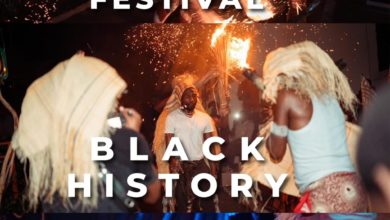Au Gabon, les masques ne sont pas de simples objets artisanaux : ils incarnent une synthèse culturelle unique, née de la rencontre entre les traditions ancestrales et les défis contemporains. Depuis l’indépendance en 1960, cette symbolique a évolué pour devenir un pilier de l’identité nationale, transcendant les frontières ethniques tout en préservant sa profondeur spirituelle. Des cérémonies villageoises aux salles du Musée National des Arts et Traditions (MNAT), ils continuent de jouer un rôle crucial dans la cohésion sociale et la transmission des savoirs.

Le Gabon compte une cinquantaine d’ethnies, chacune développant des masques aux styles et fonctions distincts . Parmi les plus emblématiques, le N’goltang (ou Ngontang) chez les fang. Il est composé de quatre visages blanchis au kaolin, symbolisant la clairvoyance et les esprits ancestraux Les masques punu, reconnaissables à leurs traits délicats et leur couleur blanche (kaolin), ils représentent l’idéal de beauté féminine et agissent comme médiateurs lors des rites initiatiques. À ne pas oublier, les masques Kota et Bakwélé, utilisés dans des contextes ritualistes. Ils reflètent la richesse artistique des régions forestières .

Ces œuvres, sculptées dans du bois ou modelées en terre cuite, intègrent des matériaux symboliques : plumes, fibres de raphia, ou fragments de miroirs pour « capter » l’invisible .
Les masques gabonais opèrent comme des ponts entre les mondes, reliant les vivants aux ancêtres et régulant la vie collective. Leur utilité s’exprime à travers: la dénonciation des sorciers, résolution de conflits, et protection des villages. Ils accompagnent les naissances, mariages, funérailles, et initiations, comme la danse mukudji des Punu, exécutée sur échasses. Les motifs et couleurs des masques « passeport » du Moyen-Ogooué, portés autour du cou, servaient jadis de cartes d’identité culturelle pour les voyageurs .

Au Musée national des arts et traditions(MNAT) , cette tradition prend une dimension nouvelle. Romane, une visiteuse gabono-canadienne, témoigne : « Une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment visiter ce musée, c’est parce qu’il porte la marque des rites et traditions du Gabon… Là, j’ai vu les masques Punu, Fang, etc. » Sa visite guidée sous la grotte du musée lui a permis de redécouvrir une culture dont elle était éloignée après une décennie passée au Canada.
Pour Lucienne Elvire Imouessé, chef de service au MNAT, les masques sont bien plus que des artefacts : « Avant l’avènement de la société policée, le masque jouait le rôle d’intermédiaire entre le monde des vivants

et celui des ancêtres. Il avait des rôles sociaux, religieux, fondamentalement de cohésion sociale et aussi de divertissement. […] Ils apportent la connaissance sur la cosmogonie. » . Son explication pédagogique souligne leur fonction éducative, essentielle pour comprendre la vision du monde gabonaise.
La valeur internationale des masques gabonais suscite aujourd’hui des débats vibrants. En 2022, un masque Fang vendu 150 euros à un brocanteur français a été revendu aux enchères pour 4,2 à 5,25 millions d’euros, déclenchant une bataille judiciaire et une demande de restitution par le Gabon . Le pays investit dans la préservation de son patrimoine, comme en témoigne le développement de la connectivité numérique pour diffuser sa culture .
Ces enjeux illustrent la tension entre marchandisation et réappropriation culturelle, alors que des artistes gabonais réinterprètent ces symboles dans l’art contemporain.
Des forêts du Moyen-Ogooué aux salles du MNAT, les masques gabonais restent des gardiens actifs de la mémoire collective. Ils rappellent, comme le résume Romane, que « le fait qu’on ait 54 ethnies au Gabon relève d’une richesse culturelle » . Entre spiritualité, art et lien social, ils continuent d’incarner une culture en mouvement, fière de son passé et ouverte sur l’avenir.